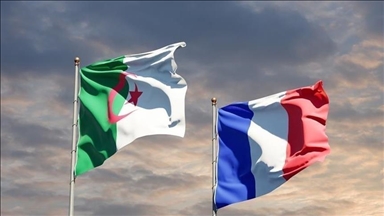Essais nucléaires en Algérie : un autre témoin des crimes indélébiles que la France refuse de reconnaître

Algeria
AA / Alger / Aksil Ouali
«Gerboise bleue». Un triste souvenir pour l’Algérie et les Algériens. Ce titre, contrairement à ce qu’il laisse entendre, renvoie un film d’horreur, dont l’acteur principal est la France coloniale.
Il est commis en Algérie à la veille de l’indépendance du pays avec des dommages collatéraux incommensurables : dégâts sur les humains et l’environnement. Une autre tache noire dans l’histoire de la France que les autorités de ce pays ne reconnaissent qu’à demi-mot, 62 ans après.
L'événement tragique remonte à un certain 13 février 1960 dans le grand Sahara algérien.
Un champion radioactif, résultat d’une bombe nucléaire plus puissante que celle qui s’était abattue sur la ville japonaise d’Hiroshima lors de la deuxième guerre mondiale, a assombri le ciel bleu de la région désertique d’Adrar. L’expérience, qui a eu lieu dans la zone de Hamoudia à Reggane au sud du pays, a ouvert la voie à une longue série d’essais nucléaires qui ont permis à la France d’entrer dans le club restreint des puissances atomiques.
Des essais qui se sont poursuivis jusqu’au 1966, soit quatre ans après l’accession de l’Algérie à l’indépendance. Pendant cette période, la France a réalisé d’autres essaies à flanc de montagne du Taourirt Tan Affela (la colline d’en haut en berbère) dans la région de Tamanrasset, à l’extrême sud de l’Algérie, qui ont dispersé, dans la nature, des quantités d’éléments radioactifs.
Ce n’est pas tout. L’ex-puissance coloniale a effectué, également, 38 expériences, dite « complémentaires » en dispersant du plutonium.
« Avant de partir, les militaires et scientifiques français ont creusé des fosses pour enterrer le matériel, installé une clôture et mis quelques panneaux d’interdiction, laissant sur place des quantités de déchets radioactifs dangereux », avaient affirmé des experts indépendants et des lanceurs d’alerte.
---Crime contre l’humanité---
Si la France a tout gagné de ces expériences, les Algériens, eux, continuent d’en pâtir de leurs effets nocifs et indélébiles. Les témoignages des habitants de ces régions le confirment. Ils continuent à ce jour à souffrir de ce crime odieux contre l’humanité et du drame causé à l’Homme et à l’Environnement. Témoin vivant, Aabella Abdallah, un octogénaire qui travaillait alors sur le site de ces explosions nucléaires, raconte l’horreur vécue ce jour-là.
« Au moment où les médias français s'enorgueillissaient de la réussite de leur pays à intégrer le cercle des puissances nucléaires avec les explosions de Reggane, les habitants locaux vivaient l’enfer et la terreur qu’ils avaient eu à subir à l’aube du 13 février 1960 du fait de ces très fortes explosions ayant provoqué de nombreuses victimes et une frayeur indescriptible », se rappelle-t-il, dans une déclaration reprise par plusieurs médias locaux.
Les explosions nucléaires ont engendré par la suite l’apparition de nombreuses maladies étranges parmi la population locale, tels que les « malformations congénitales chez les nouveau-nés », des « maladies ophtalmologiques » et des « cancers », en plus des dommages causés à l’environnement et qui se sont répercutés sensiblement sur l’agriculture.
Parmi les victimes, il y a Abderrezak Baïmoune (20 ans). Habitant du ksar d’Anzeglouf à Reggane, le jeune homme souffre d’un étrange gonflement de la jambe l’empêchant de jouir d’une vie normale comme ses pairs, lui imposant des souffrances de santé physique et psychologique, et le contraignant à des difficultés matérielles.
Pour le président de l’association « El-Gheith El-Kadem » d’aide aux malades à Adrar, Abderrahmane Touhami, ces maladies «sont engendrées par la radioactivité provoquée par les explosions nucléaires de Reggane ». Il alerte chaque année sur « la nécessité de préserver la santé publique, surtout avec la multiplication de cas de malformations congénitales chez les nouveau-nés, en plus des cas d’handicap physique et mental et de l’accroissement de divers types de cancer ».
Des médecins exerçant dans les régions contaminées confirment également que «les explosions nucléaires ont causé des pathologies jusque-là méconnues, aujourd’hui perceptibles sur la santé humaine ».
---Loi Morin, indemnisation et secret défense---
Mais malgré la confirmation du lien entre ses essais et leurs effets sur la population, la France continue sa fuite en avant. Face aux demandes de reconnaissance, d’indemnisation des victimes et de décontamination des lieux, les autorités françaises avancent à reculons sur ce dossier.
Il a fallu attendre l’année 2010 pour que, du bout des lèvres, elles commencent à admettre que les essais n’avaient pas été aussi «propres» qu’elles l’affirmaient jusque-là, avec l’adoption d’une loi de reconnaissance et d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi Morin. Mais la loi n’a bénéficié jusqu’à présent qu’un seul Algérien, qui a été indemnisé.
La France a pourtant reconnu « sa dette » envers la Polynésie française, théâtres d’essais similaires entre 1966 et 1996.
« Je ne peux que rappeler que la Polynésie est française alors que l’Algérie ne l’est plus depuis 60 ans, en plus des 132 ans d’occupation. Je veux dire que le peuple algérien n’a jamais accepté la présence française. J’ignore ce que souhaitent les Polynésiens, mais les responsables français, à mon humble avis, ne peuvent qu’accorder à des citoyens français les indemnisations, les excuses, etc. », souligne l’historien algérien Fouad Soufi dans une déclaration à l’APS (agence de presse officielle).
Et d’ajouter : « Qu’ils refusent cela à des citoyens d’un pays étranger, cela est odieux et conforte la politique du ‘’deux poids deux mesures’’ de la France à l’égard des Algériens ».
Directeur de l’observatoire des armements (France), Patrice Bouveret, relève, dans une interview accordée, samedi 12 février, au quotidien francophone, El Watan, que « l’Etat français a toujours affirmé avoir pris toutes les précautions et que ses essais nucléaires étaient ‘’propres’’ ».
Selon lui, à l’approche du 60ème anniversaire des Accords d'Evian (19 mars 1962), « la logique voudrait que le président français Emmanuel Macron reconnaisse enfin la dette de la France envers l’Algérie pour les 17 essais réalisés dans le Sahara entre 1960 et 1966 ».
Le fera-t-il ? En tout cas, un autre problème vient compliquer davantage cette question.
Il s’agit de l’accès aux archives, non encore déclassifiées, mais aussi de l’obtention par l’Algérie des documents topographiques des restes nucléaires français.
Sur ces deux questions, les négociations entre l’Algérie et la France piétinent, même si, comme l’affirme l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la mémoire, « les échanges entre les deux pays se poursuivent pour qu’un accord franco-algérien soit trouvé sur une remédiation des anciens sites d’essais».
Seulement une partie des dépêches, que l'Agence Anadolu diffuse à ses abonnés via le Système de Diffusion interne (HAS), est diffusée sur le site de l'AA, de manière résumée. Contactez-nous s'il vous plaît pour vous abonner.