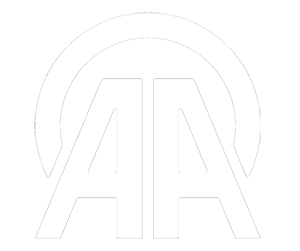Gabriel García Márquez, l’envers et l’endroit (Portrait)

Tunisia
AA/Tunis/Majdi Ismail
Gabriel José de la Concordia García Márquez. « Journaliste de l’écriture », selon ses dits, mais encore écrivain, romancier, nouvelliste, et militant politique. Son nom est Légion. La mort, la sienne, seule expérience qu’il n’a pu raconter, a eu raison de lui le 17 avril 2014 dans son domicile à Mexico. N’empêche, « Gabo anda por ahí », Gabo est dans les parages, puisqu’il a marqué de son sceau et à jamais toute une génération d’écrivains à travers le monde, qui ont comme lui, puiser le sel de leur œuvre dans l’imaginaire, la mythologie, l’enfance, et l’histoire de leur terre natale. Les cavalcades rhétoriques du Colombien et son imagination débridée ont également séduit les hommes politiques bien au-delà du monde hispanophone.
La littérature et la politique ont toujours coexisté dans l’œuvre et la vie de García Márquez, comme l’envers et l’endroit.
- Une enfance merveilleuse à Aracataca
García Márquez est né le 6 mars 1927, à Aracataca, une bourgade perdue entre les marigots et les plaines de la côte caraïbe colombienne. Il est l’aîné de onze enfants. Ce sont ses grands-parents maternels qui vont l’élever jusqu’à l’âge de huit ans après que ses parents ont quitté Aracataca, quand il avait un an. La genèse de son imaginaire, il la doit justement à ses grands-parents. Son grand-père le colonel Nicolás Márquez, ne cessera de lui raconter ses souvenirs de la guerre civile des Mille Jours qui, entre 1899 et 1902 opposa en Colombie le camp « libéral » à celui des « conservateurs » qui finiront par triompher.
L’écrivain en devenir, doit aussi sa formation intellectuelle et les fondements de sa conscience politique et sociale, ainsi qu’un certain sens de la démesure à son « Papalelo », surnom donné par Gabriel au colonel libre-penseur. Gabo sera aussi marqué par le récit de son grand-père sur le « massacre des bananeraies » : près de 1500 ouvriers agricoles en grève avaient été tués par l'armée colombienne, en décembre 1928, sous la pression de Washington qui menaçait de dépêcher ses marines si le gouvernement n'agissait pas pour protéger les intérêts de la compagnie américaine United Fruit, surnommée la Pieuvre dans toute l’Amérique latine. Cet épisode sanglant sera encré, - sous forme de fiction -, sur les pages de son opus « Cent ans de solitude », phare de la littérature latino-américaine.
Sa grand-mère galicienne va lui ressasser inlassablement des contes merveilleux où s’entremêlent le culte du surnaturel, les prémonitions, les récits des revenants, et les nécromanciennes. Cette enfance colombienne forgera son habitus.
- Le journalisme, une raison d’être
Vient le temps de l’adolescence dans la mégapole froide de Bogota. Baccalauréat en 1946, apprentissage du journalisme sur le tas, études de droit, - vite interrompues -, les nuits à se délecter du Vallenato (musique populaire des caraïbes) et à partager le lit des hespérides. Ses icônes littéraires se prénomment Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf, William Faulkner, ou encore Ernest Hemingway. Sa machine de guerre, au sens deleuzien du terme, la langue espagnole. Mais c'est en tant que journaliste que García Márquez entre dans la vie publique. Plus encore qu’un métier, le journalisme est pour le Colombien une raison d’être. « Pour moi, il n'y a pas de coupure entre le journalisme et la littérature, entre l'écriture romanesque et l'écriture journalistique ; même source, même objet, même problème : la réalité. Sauf que la réalité que traite le journaliste est plus immédiate et que le style romanesque la peint avec plus de lyrisme. Moi, je suis un journaliste de l'écriture, mes romans sont des reportages (…) Ce qui me fascine dans le pouvoir, c'est l’information : près du pouvoir, on est près de l'information, on est informé. L'information, c'est mon oxygène », dixit García Márquez, en 1978, lors d’un entretien politico-littéraire, avec le militant et intellectuel d'extrême-gauche, Pierre Goldman.
En 1955, García Márquez, jeune journaliste, publie dans le quotidien colombien, El Espectador, vingt épisodes sur la catastrophe du Caldas. Ce destroyer de la marine colombienne surchargé de marchandises de contrebande, avait perdu huit membres d'équipage en haute mer lorsque les câbles de cette cargaison avaient lâché. García Márquez apprend la vérité de la bouche du seul marin militaire rescapé. Ce récit sera repris en 1970 dans un livre intitulé « Récit d’un naufragé » qui fera date. Le succès de ce texte auprès des lecteurs d’El Espectador, oblige le quotidien colombien à envoyer García Márquez en Europe, par crainte de représailles par le régime militaire de Rojas Pinilla.
- L'étape parisienne
Il débarque sur le Vieux Continent en tant que correspondant étranger d’El Espectador, part en Italie, effectue des séjours de l’autre côté du rideau de fer, couvre la conférence de Genève entre les grandes puissances (Etats-Unis, URSS, Royaume-Uni et France) puis s’installe à Paris, capitale du tiers-monde à l’époque. Le dictateur Pinilla finira par bannir El Espectador, et le journaliste García Márquez se retrouve sans travail et sans-le-sou. Il écrit et survit, en attendant son moment de gloire.
À Paris, au plus fort de la guerre d'Algérie, le Colombien aiguise sa conscience politique au contact des cercles et militants du FLN. Il sera raflé, fouillé, exposé au ratonnade de la police de Papon en raison de sa « gueule d’arabe » dont il était fier. Il avouera par la suite que sa solidarité avec la révolution cubaine a des racines parisiennes.
En 1958, García Márquez revient en Amérique Latine, à Caracas pour suivre le renversement de la dictature militaire de Pérez Jiménez au Venezuela par un soulèvement populaire. Il épousera la même année son amour-passion de toujours, Mercedes Barcha, qu’il ne quittera plus. Les Barbudos, Ernesto Guevara, et Fidel Castro triomphent de Fulgencio Batista en 1959 et prennent le pouvoir sur l’île de Cuba. Le journaliste exprime sa profonde solidarité avec la révolution cubaine et se lie d’amitié avec le Líder Máximo. Une révolution et une amitié que Gabo ne désavouera jamais. Pour justifier son allégeance sans faille à l’expérience cubaine, il dira « Je suis profondément solidaire de la révolution cubaine. Cela veut dire que je ne suis pas seulement solidaire de ses aspects positifs mais aussi de ses aspects négatifs. Quand une révolution est dans la merde, alors il faut manger de la merde avec elle, sinon c'est trop facile, c'est facile de mettre les pouces quand arrive le temps de manger de la merde, trop facile de dire, je ne marche plus, ça pue. Je suis le plus implacable critique des aspects négatifs de la révolution cubaine - et des aspects négatifs, il y en a - mais j'opère cette critique à l'intérieur du système ».
L’écrivain journaliste travaille désormais pour l'agence de presse cubaine « Prensa Latina ». Il se fixe à Mexico, pour, disait-il, « être proche des centres importants de l'actualité latino-américaine ».
En 1962 García Márquez publie son roman, « La Mala Hora », qui remporte le Prix national de littérature de Colombie, sa première grande récompense. Sa carrière bascule en 1965 quand l’agent et éditrice espagnole, Carmen Balcells, signe un contrat avec lui, autorisant cette dernière à le représenter dans toutes les langues et dans tous les pays pour 150 ans!
- « Cent ans de solitude », la consécration mondiale
En 1967, son opus « Cent ans de solitude » lui permet d’accéder au panthéon de la littérature mondiale. Ce roman, pur produit de l’habitus de García Márquez, incarne ce qu’on appelle le « réalisme magique », cet effet d’étrangeté créé à partir d’un enchevêtrement de violence, d’épopée, de sensualité, d’éléments surnaturels, de mythologie, et d’imagination sans limite, magistralement déployé dans un langage puissant, fait d’hyperboles et d’exubérances stylistiques. L’écriture de Gabo, taillée à la serpe, fait travailler la fiction dans la vérité, pour induire des effets de vérité avec un discours de fiction. Son langage opère une prestidigitation, un retournement du réel pour le rendre merveilleux et faire naitre le soupçon chez le lecteur que le sens qu’on saisit, et qui est immédiatement manifesté, n’est peut-être en réalité qu’un moindre sens, qui protège, resserre, et malgré tout transmet un autre sens ; celui-ci étant à la fois le sens le plus fort et le sens « d’en dessous ». C’est ce que les Grecs appelaient l’« allegoria », selon la terminologie foucaldienne.
« Cent ans de solitude est comme la base du puzzle dont j’ai peu à peu donné les pièces dans mes livres précédents. Toutes les clés y sont fournies. On connaît l’origine et la fin de tous les personnages, et l’histoire complète, sans vides, de Macondo (village fictif) Bien que dans ce roman les tapis volent, les morts ressuscitent et qu’il y ait des pluies de fleurs, c’est peut-être le moins mystérieux de mes livres parce que l’auteur tente de conduire le lecteur par la main pour qu’il ne se perde à aucun moment, et qu’il ne reste aucun point obscur », explique-t-il.
Tous les lecteurs de ce monument de la littérature colombienne, seront marqués par l’incipit de « Cent ans de solitude » : « Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace ».
- Une vie d’écrivain engagé à gauche
À partir de ce moment García Márquez, mènera une vie d’écrivain engagé à gauche. Il fréquente les Vargas Llosa, Julio Cortázar, Rosa Regàs, Beatriz de Moura, Carlos Fuentes et Milan Kundera. La politique le rattrape. Le 11 septembre 1973, Augusto Pinochet, assassine l’Unité Populaire de Salvador Allende au Chili. Le « golpe » de Santiago, va contraindre le Colombien à dénigrer l’écriture des romans pour un temps, pour se consacrer à « la guerre de l’information ». L’enragé du journalisme va créer en Colombie la revue « Alternativa », - organe de contre-information -, dans laquelle il va dénoncer l’impérialisme américain, fustiger la junte militaire de Pinochet, prendre fait et cause pour le tiers-monde et soutenir ouvertement le régime castriste de la Havane.
1982 sera l’année du sacre. Les dix-huit jurés de Stockholm lui décernent le prix Nobel de littérature. Il est le premier Colombien à obtenir cette distinction, et le quatrième Latino-Américain après Gabriela Mistral, Miguel Angel Asturias et Pablo Neruda. Avec les 1 150 000 couronnes du Nobel il participera à créer la Fondation pour un nouveau cinéma latino-américain et l’École Internationale de Cinéma et de Télévision à Cuba. Plus tard, il mettra sur pied une Fondation pour le nouveau journalisme ibéro-américain à Carthagène.
L’auteur de « L’Automne du patriarche» (1975), « Chronique d’une mort annoncée » (1981), « L’Amour aux temps du choléra» (1985), ou encore « Le Général en son labyrinthe» (1989), n’aura de cesse, - au fil de ses écrits -, dépeint la fresque intime et populaire de toute l’Amérique latine, sous l’angle d’une réalité fantastique et permis à ce continent de prendre sa revanche sur l’histoire.